Ce matin, Charline pense à nos aînés, à travers un message
adressé à sa grand-mère, Claire, 98 ans, confinée seule dans sa maison
en Belgique, et qui nous écoute…
Oui, alors pour qu’elle
sache que je m’adresse à elle, je dois l’appeler par son surnom : MIMIE,
MONTE LE SON j’ai écrit pour toi !jeudi 30 avril 2020
mercredi 29 avril 2020
*Madone !
"Ce visage de madone que tu as. C’est aussi ça qui les emmerde..." - Philippe Djian
Philippe Djian est né à Paris. Son roman, "37°2 le matin" a
marqué les années 1980. Dans cette lettre adresse à Greta Thunberg, il
prend la défense de la jeune activiste et la présente comme l'emblème
d'un renouveau nécessaire.

Ma chère Greta, ma chérie,
Je suis un vieil homme, à présent. Ne crains rien. Tu es loin. Je peux te donner du ma chérie sans que ton père ne cherche à m’étrangler. C’est bien qu’il veille sur toi, qu’il traverse l’océan en bateau pour t’accompagner. J’en serais malade s’il t’arrivait quelque chose. La nuit viendrait.
Ce n’est pas le moment. Ce n’est pas une plaisanterie, c’est juste une mauvaise plaisanterie que nous vivons, comme de marcher dans du miel et en foutre partout sous ses semelles. Au-delà des images, il y a une drôle d’odeur. Je ne devrais pas la sentir à mon âge, je devrais perdre l’odorat mais je ne respire que ça, ce doux parfum de pourriture, j’en perçois toutes les saveurs. Pandemic is not for sissies. Heureusement que tu es là.
C’est quand même drôle ce qu’une bande de connards a pu dire sur toi, j’ai halluciné. Ils me dégoûtent. Mais qu’est-ce qu’ils ont dans la tête, ces gens-là. Comment font-ils pour se maintenir en vie. Ils sont écœurants, n’est-ce pas. Ils donnent envie de changer de trottoir, de respecter les distances pour une fois. Je suis désolé pour eux, ils se sont allongés dans leur tombe et se sont eux-mêmes couverts de terre, tout confits d’orgueil. On n’y peut rien, on ne discute pas avec des zombies.
Les gens ne s’arrangent pas en vieillissant. C’est une vraie tragédie. J’aime ton sourire. Tu es plus belle que le ciel et la mer. Dommage que Cendrars ai trouvé ça avant moi. Lis Cendrars. C’est la meilleure chose à faire pendant le confinement. Et puis Sur la route, bien sûr. Et quelques poèmes de Walt Whitman avant de t’endormir. Ton sourire me fait du bien. Je suis touché par ta beauté, tu as une beauté apaisante. J’emporterai ta photo avec moi quand j’irai en Ehpad. Je te soutiens à 100% dans ton combat, mais j’aime tes yeux aussi, et tes nattes. Je viens de terminer un roman où je parle de toi. Sauf que tu as la trentaine et que l’on y boit du vin importé du nord de la Suède. Je voyais aussi Naomi Klein en l’écrivant. Ce n’était pas toujours très gai comme roman, mais tu restais dans les parages, et elle aussi, et ça m’aidait, je me sentais en bonne compagnie. Ce visage de madone que tu as. C’est aussi ça qui les emmerde, cette partie qu’ils ont perdu d’avance, ces ténèbres vers lesquelles ils glissent quoi qu’ils dégoisent.
Je te l’enverrai quand les postes remarcheront. On m’a demandé de tenir un journal du confinement, mais pourquoi on ne demande pas ça à un type qui dort dans la rue si on veut savoir comment ça se passe. On voit bien que ce monde doit changer. Les choses deviennent trop absurdes au bout d’un moment.
Rien ne me convient. Aucun parti, aucune figure. Je me suis réveillé un soir et tu passais à la télé et avant même de savoir qui tu étais, je me suis levé et je me suis approché de l’écran pour te voir de plus près. Je pensais que tu portais un masque de porcelaine.
Enfin bref.
Voilà.
Cette lettre. Voilà. Ma chérie. Fais-en ce que tu veux.
Ph. – Philippe Djian
mardi 28 avril 2020
*Sourire au présent !
lundi 27 avril 2020
par Augustin Trapenard
France Inter
Lettre d'Intérieur
"Vos courriers font sourire le présent. C’est pourtant le passé qui vous submerge..."- Mona Ozouf
Mona Ozouf est née à Lannilis. Elle est philosophe et
historienne, spécialiste de la Révolution française. Dans cette lettre
en réponse à tous ceux qui lui écrivent, elle explique comment
l'évocation du passé parvient à éclairer le présent, et célèbre les
beautés et les joies de la mémoire.

Lettre à tous mes correspondants
Chers tous, ma boîte mail déborde. Pour aujourd’hui, ce sera donc, pardonnez -moi, une réponse collective : chacun reconnaîtra son bien.
En temps ordinaire vous et moi tissons la toile de nos jours avec trois fils : présent, passé, futur. Mais celui-ci brusquement nous manque. L’an dernier, à pareille époque, par ce beau temps miraculeux, vous m’auriez demandé : quels projets pour juillet, pour août ? Où çà, et avec qui ? Questions devenues oiseuses : y aura-t-il seulement un été ?
Puisque nul ne sait ce que demain nous réserve, vous vous ingéniez à meubler l’aujourd’hui avec les images des jardins où vous avez trouvé refuge. De jour en jour ma collection s’enrichit, le muguet de Catherine, la glycine d’Anne-Marie, les pensées de Sylvie, le lilas blanc de Natacha. Toutes des femmes, lectrices de Colette, filles de Sido : pas un homme ne songe à donner des nouvelles de son cactus rose. Une exception, mon fils, avec son bouquet champêtre échevelé.
Mais soyons équitables, car vous, mes vieux copains, n’êtes pas en reste de cadeaux : la visite quotidienne de Dominique, qui lit et dit si bien la prose comme la poésie, et me promène de Hugo à Perec, de Stéphane Zweig à Jean-Claude Grunberg ; les vidéos pour réfléchir, pour rire, pour s’attendrir. Comme cet irrésistible envoi d’Olivier : un Abel bouclé de deux ans et demi feuillette « Pour rendre la vie plus légère », pointe un doigt impérieux sur la page, et conte à sa manière l’histoire qu’elle recèle : à l’en croire, celle d’un dragon qui l’aurait avalé tout cru.
Vos courriers font sourire le présent. Mais c’est pourtant le passé qui vous submerge. Du temps vous est rendu, avec la tentation de lire à rebours la phrase de la vie. Toi, ma fille, qui as rouvert les vieux albums de photos de la famille. Vous, mes amis, qui me dites, contre vos attentes, préférer à la découverte de nouveaux livres les retrouvailles avec ceux que vous avez longuement fréquentés. Et vous, silhouettes qui resurgissez d’autrefois. Parfois de la haute enfance, sur fond d’une plage bretonne d’avant-guerre ; parfois des lointaines hypokhâgnes où j’ai enseigné : Françoise, qui aujourd’hui me confectionnez des masques ; Sylvie, qui m’avez raconté comment voyageait dans les familles la parole philosophique : vous pensiez avec Platon que nul n’est méchant volontairement. Votre père vous affirmait que les hommes à l’évidence veulent le mal, crois-en ma vieille expérience. Vous lui rétorquiez que Platon était aussi vieux que lui, et s’ensuivait une violente mais noble dispute.
Merci à tous pour cette brassée de souvenirs. Souvent déchirants quand ils parlent des jours heureux. Mais précieux pour vérifier ce que Rousseau disait de Saint-Preux : « Si vous lui ôtez la mémoire, il n’aura plus d’amour ».
Gardez bien la mémoire et l’amour, et faites attention à vous,
Mona Ozouf
lundi 27 avril 2020
*Ce monde-là !
Jeudi 23 avril 2020
par Augustin Trapenard
France Inter
Lettre d'Intérieur
"Est-ce ce monde-là que j’aurais aimé t’offrir ?" - Jean-Baptiste Del Amo
Jean-Baptiste Del Amo est né à Toulouse et vit dans le Loir
et Cher. En 2016, il remporte le prix du livre Inter pour "Règne
Animal". Dans cette lettre adressée à l'enfant qu'il n'aura jamais, il
se demande si mettre des enfants au monde a encore un sens aujourd'hui.

À l’enfant que je n’aurai pas.
Lorsque j’avais l’âge que, peut-être, tu aurais aujourd’hui, j’ai souvent pensé que je n’aurais jamais d’enfant. Ce qui m’attristait n’était pas tant la perspective de ne pas en avoir que l’idée de priver mes parents de petits-enfants, de les décevoir et de savoir que je resterais, à leurs yeux et à ceux des autres, inaccompli.
Et puis j’ai grandi. J’ai voulu faire de ton absence une force. Sans toi, je serais plus libre, sans devoirs, sans attaches.
Je mentirais, néanmoins, si j’affirmais que je n’ai jamais envié ceux qui ont un enfant, si je disais que ne me traverse pas, par moment, le regret mélancolique de ne pas t’avoir connu.
En vérité, je n’aurais sans doute pas grand-chose à te donner. Je n’aurais pas de solution pour te permettre de traverser la vie sans t’y brûler. Rien qui t’eût préservé de grandir, de te heurter à l’âpre réalité de ce monde, de devenir triste et grave, d’être déçu en amitié et en amour. Tu vois, plus le temps passe, moins j’ai de certitudes. Mes convictions sont fragiles et je n’ai rien appris.
Et puis regarde-nous, tristes humains, qui n’avons eu de cesse de nous définir en opposition aux autres formes de vie dans le seul but de justifier notre domination sur elles. Nous avons fait fi des signaux et des avertissements. Nous avons brûlé les forêts, puisé les énergies fossiles, acidifié les océans. Nous avons enfermé les animaux dans des fermes-usines. Nous avons fait taire les oiseaux. Nous avons poussé jusqu’au point de non-retour notre recherche avide du profit. Nous avons érigé en modèle le capitalisme le plus cynique et désabusé, au mépris du plus faible que nous lui sacrifions sans ciller : l’animal, le migrant, le vieux, le malade, l’ouvrier.
Est-ce ce monde-là que j’aurais aimé t’offrir?
D’aucuns diront qu’il faut avoir de l’espoir, croire aux générations futures. Mais ce n’est là qu’une énième façon de nous dédouaner de toute responsabilité, comme l’a fait la génération de nos parents dans les années 70, lorsque les politiques et le lobby industriel ont œuvré à enterrer un accord international majeur sur le climat et à museler les lanceurs d’alerte. Trente ans plus tard, les USA et le Brésil sont dirigés par des climato-sceptiques, les millionnaires de la Silicon-Valley investissent dans des bunkers en Nouvelle-Zélande en prévision de l’effondrement et l’humanité tremble devant la nouvelle pandémie qui la frappe.
L’essayiste américain Nathaniel Rich le dit : nous aurions pu sauver la Terre et nous ne l’avons pas fait.
Alors oui, parfois, un regret me traverse, comme en ce moment, de ne pouvoir partager avec toi ce début de printemps, le parfum du pommier qui vient de fleurir, l’émerveillement de trouver une petite couleuvre derrière le vieux tas de bois, ce livre pour enfants que j’ai écrit en sachant que je ne te le lirais pas.
Je me console en me disant que si, sans toi, je perds sans doute beaucoup, tu ne manques en revanche pas grand-chose.
Jean-Baptiste Del Amo
dimanche 26 avril 2020
*Le Joueur de Luth

|
|
De Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit Caravage, peintre italien né le à Milan et mort le à Porto Ercole.
vendredi 24 avril 2020
*Le roi Jean
Il y a longtemps, dans une autre vie, j'habitais le pays de Jean Giono, un morceau de paradis tombé en Haute-Provence. Je m'étais installé à Pierrevert, près de Manosque, exprès pour pouvoir marcher sur ses pas en fin de semaine, arpenter la rue Grande, respirer son air, trouver dans son sillage "le silence et la paix gorgée de richesses".
C'était un gai luron qui n'avait laissé que de bons souvenirs. Un de ses anciens amis manosquin me raconta qu'un jour, alors qu'il se soleillait avec le grand homme à la terrasse du glacier, son café officiel, remplacé depuis par une banque, un touriste lui avait demandé le chemin de l'église Notre-Dame de Romigier.
Giono lui avait indiqué la direction inverse avec une profusion de détails : il fallait passer avant de bifurquer à droite, descendre la route, tourner à gauche et, avant le ruisseau qui coule son jus noir, entrer dans un parc et patin-couffin....
Pendant que le touriste s'éloignait, l'ami s'indigna : "Enfin, Jean, pourquoi l'as-tu envoyé dans le sens contraire, si loin de l'église ?" Alors, le grand écrivain : "Parce que ça lui fera du bien de voir du pays !" Tel était Giono : cosmique, rustique, farceur, amateur de bonnes histoires, surtout quand elles étaient fausses. Il a donné au panthéisme une langue, un corps, une incarnation.
Dans la dernière nouvelle de son recueil Solitude de la pitié, il écrit : "Je sais bien qu'on ne peut pas concevoir un roman sans homme, puisqu'il y en a dans le monde. Ce qu'il faudrait, c'est le mettre à sa place, ne pas le faire au centre de tout." Pourquoi faut-il que la littérature tourne toujours autour de
lui ?
lui ?
Giono préconise de faire vivre d'autres habitants de l'Univers.
Par exemple, un fleuve. Au même titre qu'un humain, c'est un personnage "avec ses rages et ses amours, sa force, son dieu hasard, ses maladies, sa faim d'aventures". De même les rivières et les sources. Ce sont aussi des personnages, écrit Giono, "elles aiment, elles trompent, elles mentent, elles trahissent, elles sont belles, elles s'habillent de joncs et de mousses". Avec les champs, les landes, les collines, les plages, les océans et beaucoup d'autres choses, tout cela forme "une société d'êtres vivants" et il serait temps que nous tenions enfin compte des "psychologies telluriques, végétales, fluviales et marines".
De livre en livre, Giono développe sa conception panthéiste et animiste de l'Univers. Dans Jean le Bleu, son autobiographie, il écrit : "Nous sommes le monde." Puis il explique : "Le vent, les oiseaux, les fourmilières mouvantes de l'air, les fourmilières du fond de la terre, les villages, les familles d'arbres, les forêts, les troupeaux, nous étions tous serrés grain à grain comme une grosse grenade, lourde de notre jus".
Aucune idéologie là-dedans, fors celle de la terre que célébra le régime de Vichy sous l'occupation nazie : elle valut à Giono, par ailleurs pacifiste militant, quelques ennuis après la Libération, une détention de cinq mois et une interdiction de publication suivie d'une quarantaine de presque six ans.
Chez Giono, pas la moindre tentative de théorisation. Il ne creuse pas, il sent. Il ne pense pas, il trace.
Mais le chantre de la paysannerie a expérimenté ses intuitions panthéistes à partir de 1935 en réunissant régulièrement en communauté plusieurs dizaines d'amis sur le plateau du Contadour, loin du monde, pour y vivre la joie, mot qui revient tout le temps dans Les Vraies Richesses, le livre qu'il consacre à cette aventure.
Dans ce texte, Giono dénonce la société de l'argent et la vie citadine : "Tu n'es plus au moyeu de la roue mais dans la roue, et tu tournes avec elle." Prêcheur d'humilité, il s'en prend aussi à la vanité de la culture des villes : "Les systèmes philosophiques ne s'essayaient qu'à te perfectionner dans la connaissance de toi-même. Les efforts qu'on faisait pour tout expliquer et tout ordonner par rapport à toi t'avaient donné une orgueilleuse idée de ta position dans le monde."
Même s'il s'est toujours cantonné à son travail d'écrivain, Giono aurait pu, avec un petit effort, devenir un prophète à la Bouddha. Sa maison, Lou Paraïs, perchée sur un flanc du mont d'Or, a été vendue à la ville de Manosque et rien n'empêche qu'elle ne devienne un jour un lieu de culte drainant chaque été des dizaines de milliers de pélerins, venus de l'autre bout du monde pour lire à haute voix, la nuit, les textes sacrés du gionisme.
Dieu m'a souvent rendu visite quand j'habitais le pays de Giono. Un sourire, une espèce de vertige, un chatouillis dans la poitrine, un sentiment d'harmonie devant sa présence. C'étaient les quatre signes. La plupart du temps, je les ressentais lorsque je venais contempler la Vierge noire de l'église Notre-Dame de Romigier que je fréquentais beaucoup à l'époque, au point de passer pour un crapaud de bénitier. Si je restais longtemps à la regarder, je pleurais de bonheur. Mais des fois, ça ne marchait pas et je rentrais bredouille, l'âme en peine, à la maison.
J'étais à peu près sûr de rencontrer Dieu, même l'hiver, quand j'allais au nord de Manosque, à Sisteron, au sommet de la citadelle de Vauban, et me retrouvais au milieu des montagnes blanches comme la mort qui crevaient le ventre de gros nuages noirs, pourchassés par le vent. Par beau temps, je vérifiais qu'il n'y avait personne avec moi sur la forteresse pour céder à mon irrépressible envie de hurler mon bonheur à tue-tête.
Non loin de là, sur le plateau de Ganagobie où trône un monastère bénédictin d'une humilité orgueilleuse, à pic au-dessus de la vallée de la Durance, le même Dieu accourait dès qu'il entendait le bruit de mes pas sur les pierres. J'en vins à me demander s'il n'habitait pas là au milieu des aigles. Je l'ai vu aussi régulièrement à Valensole ou à Sainte-Croix-du-Verdon. Je crois n'être jamais tombé autant de fois sur lui que pendant la période où j'habitais les Alpes-de-Haute-Provence.
Le corps de Dieu est gravé partout, dans nos yeux, nos coeurs, nos âmes. Le voir est donné à chacun d'entre nous, à condition de savoir qu'il est là et de l'attendre. Il est comme les chats. Il vient quand il veut et où il veut, mais il vient toujours, un jour ou l'autre.
Franz-Olivier GIESBERT
La dernière fois que j'ai rencontré Dieu
Gallimard
ps: En 1985, le Paraïs devient le siège de l’association Les Amis de Jean Giono, qui accueille et guide visiteurs et chercheurs, gère le fonds d’archives et organise les Rencontres Giono chaque été.
Mais le chantre de la paysannerie a expérimenté ses intuitions panthéistes à partir de 1935 en réunissant régulièrement en communauté plusieurs dizaines d'amis sur le plateau du Contadour, loin du monde, pour y vivre la joie, mot qui revient tout le temps dans Les Vraies Richesses, le livre qu'il consacre à cette aventure.
Dans ce texte, Giono dénonce la société de l'argent et la vie citadine : "Tu n'es plus au moyeu de la roue mais dans la roue, et tu tournes avec elle." Prêcheur d'humilité, il s'en prend aussi à la vanité de la culture des villes : "Les systèmes philosophiques ne s'essayaient qu'à te perfectionner dans la connaissance de toi-même. Les efforts qu'on faisait pour tout expliquer et tout ordonner par rapport à toi t'avaient donné une orgueilleuse idée de ta position dans le monde."
Même s'il s'est toujours cantonné à son travail d'écrivain, Giono aurait pu, avec un petit effort, devenir un prophète à la Bouddha. Sa maison, Lou Paraïs, perchée sur un flanc du mont d'Or, a été vendue à la ville de Manosque et rien n'empêche qu'elle ne devienne un jour un lieu de culte drainant chaque été des dizaines de milliers de pélerins, venus de l'autre bout du monde pour lire à haute voix, la nuit, les textes sacrés du gionisme.
Dieu m'a souvent rendu visite quand j'habitais le pays de Giono. Un sourire, une espèce de vertige, un chatouillis dans la poitrine, un sentiment d'harmonie devant sa présence. C'étaient les quatre signes. La plupart du temps, je les ressentais lorsque je venais contempler la Vierge noire de l'église Notre-Dame de Romigier que je fréquentais beaucoup à l'époque, au point de passer pour un crapaud de bénitier. Si je restais longtemps à la regarder, je pleurais de bonheur. Mais des fois, ça ne marchait pas et je rentrais bredouille, l'âme en peine, à la maison.
J'étais à peu près sûr de rencontrer Dieu, même l'hiver, quand j'allais au nord de Manosque, à Sisteron, au sommet de la citadelle de Vauban, et me retrouvais au milieu des montagnes blanches comme la mort qui crevaient le ventre de gros nuages noirs, pourchassés par le vent. Par beau temps, je vérifiais qu'il n'y avait personne avec moi sur la forteresse pour céder à mon irrépressible envie de hurler mon bonheur à tue-tête.
Non loin de là, sur le plateau de Ganagobie où trône un monastère bénédictin d'une humilité orgueilleuse, à pic au-dessus de la vallée de la Durance, le même Dieu accourait dès qu'il entendait le bruit de mes pas sur les pierres. J'en vins à me demander s'il n'habitait pas là au milieu des aigles. Je l'ai vu aussi régulièrement à Valensole ou à Sainte-Croix-du-Verdon. Je crois n'être jamais tombé autant de fois sur lui que pendant la période où j'habitais les Alpes-de-Haute-Provence.
Le corps de Dieu est gravé partout, dans nos yeux, nos coeurs, nos âmes. Le voir est donné à chacun d'entre nous, à condition de savoir qu'il est là et de l'attendre. Il est comme les chats. Il vient quand il veut et où il veut, mais il vient toujours, un jour ou l'autre.
Franz-Olivier GIESBERT
La dernière fois que j'ai rencontré Dieu
Gallimard
ps: En 1985, le Paraïs devient le siège de l’association Les Amis de Jean Giono, qui accueille et guide visiteurs et chercheurs, gère le fonds d’archives et organise les Rencontres Giono chaque été.
mercredi 22 avril 2020
Francis Cabrel - Les Murs de Poussière, Petite Marie, C'est Écrit, Sarba...
Ses mots,
Ses harmonies,
Ses chansons
Sa corde romantique
Découvrent en ce jour
De pluie de vent ou de sOleil
Une connotation différente
Dans le gris délavé de nos vies !
Ils sècheront ensemble
Dans le pré envers et contre tous
Nos pas ondulés à l'amble.
Ses notes affamées assoiffées dorées
Enluminent nos chemins périlleux
En ce temps qui court
Attaché à nos clous.
Je me souviens
Et m'envole dans un soupir de laine
Son langage aux tons chauds qui conte.
Den
Bonne journée les Âmi(e)s
Ses harmonies,
Ses chansons
Sa corde romantique
Découvrent en ce jour
De pluie de vent ou de sOleil
Une connotation différente
Dans le gris délavé de nos vies !
Ils sècheront ensemble
Dans le pré envers et contre tous
Nos pas ondulés à l'amble.
Ses notes affamées assoiffées dorées
Enluminent nos chemins périlleux
En ce temps qui court
Attaché à nos clous.
Je me souviens
Et m'envole dans un soupir de laine
Son langage aux tons chauds qui conte.
Den
Bonne journée les Âmi(e)s
dimanche 19 avril 2020
*Le billet de Charline
mercredi 15 avril 2020
par Charline Vanhoenacker
France Inter
France Inter
Une lettre à ma grand mère (98 ans)
Chère Mimie, nous ne pourrons nous revoir qu’à la mi-mai. Encore un mois à attendre, mais bon, qu'est-ce qu'un mois quand on a déjà traversé 98 années. Tu sais, si on ne vient pas te voir, c’est pour te protéger. Quant à te laisser sortir, je pense que tu n’aimerais pas ce qui se passe dehors : des queues devant les magasins d'alimentation, des gens qui dénoncent leurs voisins... tu dirais que c'est "reparti comme en 40"… A quelques détails près, parce que pour la plupart, on profite de la bonne bouffe, on boit des coups, et après, on gesticule une heure sur un tapis de sol devant des tutos abdos-fessiers.
Tu auras déjà tout connu dans ta vie : la guerre, le choc pétrolier, Alain Juppé avec des cheveux, et voilà qu’à 98 ans, tu dois faire face à une pandémie. Rien ne t’aura été épargné. Je me rappelle le 16 mars quand tu m’as dit : « oula, j’ai aussi connu la canicule, heureusement j’étais encore jeune à l’époque ! » Et en effet, en 2003, tu n’avais que 81 ans. Je mesure la chance que tu as de pouvoir rester chez toi, d’autant que tu as en permanence une infirmière à domicile : toi-même, puisque c’était ton métier. C'est donc pas cette pandémie qui va te faire peur, et tu demandes plutôt quel prochain péril tu devras affronter en 2040...
Je suis rassurée de ne pas te savoir en Ephad, les soignants y font un travail remarquable, mais j’ai appris qu’en Belgique, les militaires viennent en renfort dans les maisons de repos. Je pense à ta copine Paula qui y séjourne, j’espère qu’elle va bien. Ca doit lui faire bizarre de voir arriver un type en treillis pour lui servir sa camomille... A son âge, si c’est pas malheureux de devoir encore faire son lit au carré… Remarque, ils ont sans doute des trucs à se dire. Je la vois d’ici : « J’ai connu un beau jeune homme en uniforme comme vous, quand j’étais jeune ! »
Tiens bon, il nous suffit de rester chez soi. Rester planquée, tu connais, tu as été résistante. En plus, là, tu peux écouter la radio à fond sans risquer de voir débarquer la gestapo dans ton salon. Je sais que tu écoutes le 7/9 tous les matins. D’ailleurs, tu me demandes souvent : « Et Léa Salamé, est-ce qu’elle est gentille avec toi ? Parce que ta chronique est prévue à 7h57 et à 59, elle pose encore une question. » Ce à quoi je réponds : « Oui, mais c’est parce qu’elle a de grandes ambitions pour moi : son objectif c’est que je présente le journal de 8h ! »
Je pense aussi à ce que tu dis à chaque épreuve. Et ça, j’avais envie de le partager avec les auditeurs, parce que ça va leur faire du bien. Tu lèves ton verre de champagne, et tu dis bien haut : « Puisque le malheur nous accable, avalons la douleur ! »
samedi 18 avril 2020
*J'écris.....d'une chambre à soi
mercredi 8 avril 2020
par Augustin Trapenard
France Inter
Lettre d'Intérieur
"À ceux qui rêvent d’une chambre à eux, de quatre murs, d’une porte qu’on puisse fermer..." - Leïla Slimani
Leïla Slimani est née au Maroc. En 2016, elle a remporté le
prix Goncourt pour "Chanson douce". Dans cette lettre adressée aux
"incarcérés du monde entier", elle nous invite à regarder au-delà des
quatre murs de nos espaces confinés.

J’écris aux incarcérés du monde entier. Aux détenus de droit commun, aux emprisonnés politique, aux bagnards, à ceux qui croupissent dans un cachot et qui ignorent pourquoi. J’écris aux femmes cloitrées, sous des voiles ou entre des murs, aux femmes empêchées de sortir, de se mêler aux autres, de toucher et d’être touchée. J’écris aux fous qui se tapent la tête contre des murs, qui ruminent des pensées vagues, qui pleurent d’une peine dont ils ne connaissent pas le nom. J’écris à vous, qui vivez sous blocus, dans les rues de villes en guerre, dans la terreur des bombes, des attaques, de l’ensevelissement de votre monde. J’écris aux médecins qui soignent dans les souterrains de Syrie des enfants rendus fous par la solitude et le confinement. J’écris aux trois millions d’enfants qui meurent, chaque année, de faim et de notre indifférence. J’écris aux réfugiés de toutes les guerres, à ceux qui sont nés dans des camps et pour qui le monde n’est qu’un rêve, un lieu lointain et qui ne veut pas d’eux. Ces camps où des enfants de huit ans se coupent les veines car l’avenir n’est qu’un mot, vide de lumière et de sens. J’écris à ceux qui vivent enfermés entre des barbelés et des check point, aux enfants de Gaza, du Yémen et du Venezuela. A ceux qui ne trouvent plus de stylos, ni de médicaments, à ceux qui ne peuvent apaiser les cris de faim de leurs enfants. J’écris à ceux qui grandissent sous des pouvoirs qui les broient, qui les empêchent de parler et de rire et pour qui la terreur est le nom du quotidien. J’écris à nos vieux, nos ancêtres, nos sages qu’on voit traîner parfois dans les rues de Paris, poussant un caddie à moitié vide. Ils ont les cheveux jaunes, la mine grise, ils n’ont parlé à personne depuis deux jours et à la caisse, ils entament la conversation, surpris d’entendre le son de leur propre voix. J’écris aux enfants bulles, aux malades, aux impotents qui connaissent la solitude ultime du corps, qui savent qu’il y a des douleurs qu’on ne peut partager. Des douleurs qui se logent dans les os, dans le sang, qui ronge nos chairs et que l’amour des autres ne suffit pas à apaiser. J’écris aux cadavres, ceux qui pourrissent dans la mer de mon enfance, ceux qu’on enterrent sous des pierres tombales qui ne portent pas de nom, sur les plages de Cadix, de Lesbos ou de Lampedusa. J’écris aux enfants qu’on met dans des cages, aux frontières de la plus grande démocratie du monde et qui la nuit, cherchent les bras de leur mère. J’écris aux femmes battues qui entrent chaque soir chez elles comme on entre en cellule, terrifiées par le geôlier qui les attend, le poing fermé, la matraque à la ceinture. J’écris aux vagabonds, aux clochards, aux femmes et aux hommes qui vivent sous la pluie et le vent. A ceux qui rêvent d’une chambre à eux, de quatre murs, d’une porte qu’on puisse fermer. D’un lieu d’où ils pourraient ne pas sortir et où personne ne pourrait entrer.
Leïla Slimani
vendredi 17 avril 2020
Le chanteur Christophe en 5 chansons
En hommage à ce chanteur original, travailleur acharné, ...
Une partie de notre jeunesse s'envole avec lui....
Repose en paix Christophe.
Une partie de notre jeunesse s'envole avec lui....
Repose en paix Christophe.
Je l'ai rencontré lors de ses tous débuts, pour Le Bal du Bapt's à Aix en Provence à l'Ecole des Arts et Métiers où il était l' invité d'honneur.
C'était en 1965.
C'était en 1965.
Nous savions déjà qu'il traverserait le temps, les époques.
Un être authentique.
"Le peintre sonore".
Un être authentique.
"Le peintre sonore".
Den
*Mon Cher Village,
mercredi 15 avril 2020
par Augustin Trapenard
France Inter
Lettre d'Intérieur
France Inter
Lettre d'Intérieur
"Nous vivons (...) la revanche des lieux où l’on dit que « tout est mort »" - Cécile Coulon
Cécile Coulon est née dans le Puy de Dôme. Dans cette lettre
adressée au village Eyzahut, elle rend hommage aux milliers de communes
de moins de 500 habitants, si souvent oubliées, et pourtant peu
touchées par le Covid 19.

Eyzahut, cher village,
Je ne te demande pas si tu vas bien : je sais que tu vas bien. Dans tes mâchoires de pierre arrosées par les ruisseaux, habillées des arbres que le printemps doit fleurir et des oiseaux réfugiés dans tes hauteurs, je ne m’inquiète pas pour toi, ni pour celles et ceux qui vivent dans tes maisons, serrées les unes contre les autres comme des meilleures amies un soir de premier bal.
Eyzahut tu as un drôle de nom : Eyzahut, cela signifie 'hautes maisons'. Village élevé qui élève lui-même quelques cent soixante habitants. On ne te voit jamais aux informations, à la télévision. On ne t’entend jamais à la radio. On te lit quelques fois, dans le journal local, au moment des tournois et des élections. Eyzahut, tu es si beau, une beauté d’autrefois, une beauté bien cachée.
Je t’écris cette lettre par-dessus tes ruisseaux, au-delà des falaises, en remontant les massifs de l’autre côté de l’Ardèche. Je suis nichée dans un appartement qui a bien peu d’âme à côté de ton antique demeure. Je t’écris car il y a tant d’Eyzahut en France, tant de si petits villages qui ont failli mille fois mourir mais où, aujourd’hui, personne ne meurt.
Pas de médecin. Pas de commerce. Accès difficile. Eyzahut, on dit qu’en temps de repli en chaque homme fleurit ce qui, pour lui, a le plus de valeur : avant je rêvais d’un bord de mer inconnu, de ventes et d’honneurs, aujourd’hui je ne rêve que de venir jusqu’à toi, emprunter cette route étroite et venir me planter dans ton cœur.
Ce confinement n’est pas nouveau pour toi. C’est comme cela que tu vis, chaque jour, c’est comme cela que tu tiens, retranché derrière tes murs que la lumière du jour doit, en cette saison, baigner de rouge et de bleu clair. On me dit que tu as un peu toussé, qu’il y eut dans une chambre une légère fièvre. La mairie reste ouverte pour les attestations, quand on va aux courses il faut attendre devant les portes coulissantes un peu plus longtemps.
Eyzahut, la France compte 19 000 places fortes comme toi, 19 000 communes de moins de 500 habitants où la vie n’a pas tant changé depuis un mois. Ce n’est pas le diable qui se niche dans les détails, mais la vieillesse que tu connais si bien pour l’abriter depuis longtemps à côté des nouvelles familles venues pour voir grandir dans tes bras tordus leurs enfants.
Nous vivons en direct la revanche des lieux où l’on dit que 'tout est mort' à l’année, et qui aujourd’hui ne sont pas, ou peu, inquiétés. 'Ici on ne meurt pas de ces choses-là', disent les plus âgés, le village n’est pas mort, il est juste apaisé. Eyzahut tu apparais en ces temps de repli comme un refuge de conte de fées : la falaise est ton masque, la hauteur ton vaccin. Eyzahut, je ne m’inquiète pas, je sais que tu vas bien. En ce jour, tu es une leçon que je croyais avoir appris, mais il me manquait la peur de perdre le calme et les forces que tu m’avais promis".
Cécile Coulon
jeudi 16 avril 2020
Les Battements - Hommage à ceux qui à 20h applaudissent
Il est médecin anesthésiste-réanimateur au CHU de Reims et a pris sur son temps libre (très rare en ce moment) pour remercier les clappeurs de 20 heures.
Dans un long poste magnifiquement écrit et publié dans la nuit de jeudi 9 à vendredi 10 avril , le Professeur Beny Charbit explique que « le nombre de malades en réanimation diminue enfin grâce à vos efforts de confinement, ô combien difficiles. Toute l’équipe d’anesthésie-réanimation au CHU de Reims, comme dans tout le pays, reste vigilante et entièrement mobilisée 24h/24 pour les malades du Covid, sans bien sûr oublier les autres patients. »
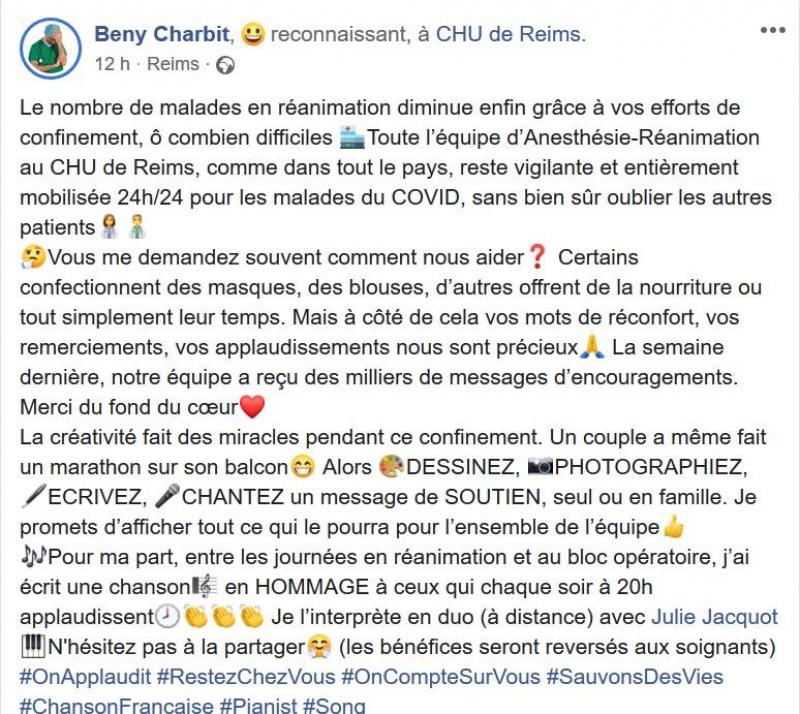
« En tant que soignant du Covid », celui qui travaille au CHU de Reims depuis 2013 remercie ensuite tous les anonymes qui confectionnent masques et/ou blouses ou offrent de la nourriture, du temps et des mots de réconfort et d’encouragement qui sont « précieux » pour tous les soignants.
« Pour ma part, poursuit-il, entre les journées en réanimation et au bloc opératoire, j’ai écrit une chanson en hommage à ceux qui chaque soir à 20 heures applaudissent. » Son titre : « Les battements ». Le professeur l’interprète en duo (à distance) avec la jeune chanteuse sparnacienne Julie Jacquot.
mercredi 15 avril 2020
*Merci
jeudi 9 avril 2020
par Augustin Trapenard
France Inter
Lettre d'Intérieur
"Je suis venue te dire adieu ; je préfère te murmurer : merci" - Nina Bouraoui
Nina Bouraoui est née à Rennes. Elle a grandi entre
l'Algérie et la France. Dans son oeuvre empreinte de violence et de
délicatesse, elle s'aventure sur les terrains de l'intime, de l'identité
et de l'écriture. Dans cette lettre, elle rend un dernier hommage à son
grand-père maternel, disparu en mars.

Cher grand père, tu t’en vas en ce sombre mois de mars dans le salon bleu de la maison du Tabor, là où Simone, ton épouse, s’éteignait déjà, il y a quinze ans, sans moi.
Je crois en la puissance des regrets : pardon. Je crois en la puissance des espaces : Simone t’attend et t’accompagnera, dès que tu te sentiras prêt à la suivre, vers l’Invisible.
Enfant, le salon bleu était ma partie préférée de la maison, lieu transitoire de mes vacances d’été avant de gagner Saint Malo, Saint Briac, Saint Lunaire, terres de mes amours primitives et solaires ; salon secret où je m’enfermais à la recherche d’un trésor que je n’ai jamais trouvé ; peut-être savais-je déjà qu’il serait votre dernier abri et le lieu de notre dernier rendez-vous.
Je me tiens près de toi, les mains ouvertes et le cœur perdu, interdite d’étreinte et de baiser, tu es si fragile et tu sembles si fort, escorté par ta beauté qui ne t’a jamais quitté. Je te regarde à peine, j’ai peur de te brûler.
Je suis sans mot, et pourtant, j’ai tant écrit sur notre famille qui n’a su ni s’entendre, ni se retrouver.
J’ai appris, tard, que tu me lisais, avec admiration et parfois fierté, mais la littérature peut échouer face au mur du silence.
Longtemps nous fûmes de faux adversaires, doux car désarmés.
En raison peut-être de ton très grand âge, nous nous sommes un jour rapprochés, sans devenir de véritables alliés, restant sur nos gardes, mais nous écrivant, nous appelant, nous aimant je crois : nous étions comme les marins qui se saluent en pleine mer pour se protéger.
Tu portes un tricot blanc à manches courtes, tes bras sont posés sur le drap qui couvre ton ventre, ton corps, sec, noueux, me fait penser au corps de Samuel Beckett que Richard Avedon a photographié. Je scelle vos deux images à tout jamais, unissant nos univers et nos croyances.
Je te promets d’honorer ta mémoire et laisse-moi te ramener au Merveilleux d’un matin d’août, au lendemain de mes neuf ans, quand nous gravissions le sentier d’une colline qui nous éloignait de Nîmes, des arènes, de sa foule bruyante.
Nous étions ivres de liberté, grimpant sans compter nos forces, les jambes griffées par les ronces et les orties.
Nous étions fous de bonheur, tendus vers un but invisible dont nous avions tous les deux la prémonition.
Tu m’attendais quand je tardais et je t’attendais quand je te dépassais ; jamais je n’aurais été autant ta petite fille et jamais tu n’auras été autant mon grand père.
Derrière les herbes hautes nous découvrîmes enfin les ruines d’un château médiéval.
Nous avons escaladé les tours à demi détruites, franchi les seuils des chambres et des salons, nous avons dansé avec des fantômes et gravi les marches du donjon.
Nous avions de l’imagination, mais une chose existait : unis par les branches d’un seul arbre, j’appartenais à ton histoire, moi, si hantée par mes origines qui nous aurons tant séparés.
Je suis venue te dire adieu ; je préfère te murmurer : merci.
Nina Bouraoui
mardi 14 avril 2020
*L'Art, la Beauté, l'Amitié
vendredi 10 avril 2020
par Augustin Trapenard
France Inter
Lettre d'Intérieur
"L’art, la beauté, l’amitié m’ont aidé à abolir l’obsession de la mort." - Tahar Ben Jelloun
Tahar Ben Jelloun est né à Fès et vit à Paris. En 1987, il
remporte le prix Goncourt pour "La nuit sacrée". Peu de temps avant le
début du confinement, il a contracté le virus du Covid 19. Dans cette
lettre adressée à un ami éloigné, il raconte son expérience de la
maladie et comment il s'en est sorti.

Lettre à l’ami éloigné
Depuis que nous sommes confinés, chacun dans un pays, je sens que le temps qui nous unissait, nous sépare aujourd’hui.
Si je n’ai pas donné signe de vie durant deux semaines, c’est parce que j’ai été contaminé et je suis heureux aujourd’hui de t’annoncer que je suis guéri. Oui, je fais partie de ces 95% de personnes ayant attrapé le coronavirus, qui ont eu la chance de le vaincre.
Mon silence était fait d’angoisse et d’espoir. Je ne voulais pas ajouter de l’inquiétude au stress que tu vivais.
Cela a commencé comme un petit rhume, mal à la tête, perte de l’odorat et du goût, puis une grande fatigue. Je me suis isolé chez moi, je ne suis plus sorti, je n’ai vu personne et j’ai attendu. J’ai appelé nos amis communs pour les prévenir que la fête, toutes les fêtes, sont reportées. J’ai vécu des moments de haute solitude où je faisais des efforts pour ne pas me projeter dans le futur. J’essayais de vivre au présent. Alors, avec de la persévérance, j’ai réussi à m’accrocher à la joie, à l’idée du bonheur, aux heures merveilleuses qui nous ont élevés vers une belle amitié.
Fatigué mais pas abattu. J’écoutais John Coltrane et je volais sur les ailes de son génie. Je passais ensuite à Charlie Parker et je me laissais aller dans sa « Nuit en Tunisie ». Je voyageais, je voguais et je pensais à toi, à nous. Mon imagination m’aidait à m’éloigner de la maladie. Au fond de moi, je luttais en silence pour empêcher le virus d’atteindre mes poumons.
J’ouvrais ensuite le grand livre sur Henri Matisse, et je me retrouvais à Tanger en 1912 en compagnie de Zohra qui posait pour lui. J’entrais dans la vision du paradis telle qu’il l’a peinte dans « Les Marocains », une toile énigmatique que nous avions tant admirée ensemble lors de sa dernière exposition à Beaubourg, c’était un jour de mai 2012.
L’art, la beauté, l’amitié m’ont aidé à abolir l’obsession de la mort. Oui, j’avoue avoir senti la mort rôder autour de la maison. Mais, je résistais en maintenant mon rituel de vie. Je me rasais tous les matins, comme d’habitude ; je faisais ma toilette et je m’habillais avec des habits de couleur comme si je partais te retrouver pour déjeuner dans nos restaurants favoris. Je me mettais à mon bureau et j’essayais de travailler.
J’ai découvert que le confinement n’est pas propice à l’écriture. Le temps, largement étendu, m’enveloppait comme du lierre m’empêchant de bouger. Alors, je me levais et je convoquais nos souvenirs tenaces. Les souvenirs du temps de la joie et de l’insouciance.
Depuis que je suis guéri, je sens que cette épreuve m’a donné une énergie nouvelle ; je suis vivant, comme tu sais, j’aime la vie. Je regarde autrement le ciel et le soleil, je suis plus attentif au chant des oiseaux et à la santé des autres, à mes proches et aussi à mes voisins. Je vais mettre des gants et un masque avant d’aller faire mes petites courses ; je passerai chez la voisine du deuxième, très âgée, qui vit seule, je prendrai sa liste des choses à acheter. Et puis j’attendrai que les frontières s’ouvrent pour nous retrouver.
Tahar Ben Jelloun
lundi 13 avril 2020
Cet aujourd'hui qui est le tien
Lundi 13 avril 2020
par Augustin Trapenard
France Inter
Lettre d'Intérieur
"Donne du courage autour de toi et n’accepte jamais ce qui te révulse..." - Wajdi Mouawad
Wajdi Mouawad est auteur et metteur en scène. Il est né au
Liban. Depuis 2016, il est directeur du Théâtre de la Colline. Dans
cette lettre adressée à l'homme que sera son fils, il s'interroge sur le
monde laissé aux générations futures, et réaffirme la puissance des
valeurs que sont l'amour, le courage et la bonté.

Mon cher petit garçon,
T’écrire ces quatre mots me bouleverse. Ils rendent si réel l’homme que tu es, en cet aujourd’hui qui est le tien, quand, dans celui qui est le mien, tu n’es encore qu’un enfant.
Cette lettre je l’adresse donc à l’homme que tu n’es pas encore pour moi, mais que tu es devenu puisque te voilà en train de la lire. Tu l’auras trouvée sans doute par hasard sur cette clé où je consigne en secret les trésors de ton enfance. J’ignore l’âge que tu as, j’ignore ce qu’est devenu le monde, j’ignore même si ces clefs fonctionnent encore mais j’ai espoir que, la découvrant, tu trouveras un moyen de l’ouvrir.
Et par la magie de l’écriture, voici que cette lettre devient la fine paroi qui nous relie, et entre l’aujourd’hui où je t’écris - où tu commences à déchiffrer les phrases, où tu as peur dans le noir, où tu crois à la magie - et celui où tu me lis, chaque mot de ma lettre a gardé sa présence ; si à l’instant j’écris je t’aime, voilà qu’à ton tour, des années plus tard, tu lis je t’aime. Et que t’écrire d’autre que je t’aime, alors que nous vivons ce que nous vivons en ce confinement dont tu n’as peut-être plus qu’un vague souvenir ? Quoi dire de plus urgent que l’amour ?
En ces journées étranges où rode une mort invisible et où le monde va vers son ravin, un ravin qui semble être l’héritage laissés aux gens de ta génération, un père, plus que de raison, s’inquiète pour son fils. Je te regarde. Tu dessines un escargot. Tu lèves la tête et tu me souris. "Qu’est-ce qu’il y a papa ?" Rien mon garçon.
Je ne sauverai pas le monde. Mais j’ai beau ne pas le sauver, je peux du moins te désapprendre la peur. T’aider à ne pas hésiter le jour où il te faudra choisir entre avoir du courage ou avoir une machine à laver. T’apprendre surtout pourquoi il ne faudra jamais prononcer les mots de Cain et, toujours, rester le gardien de ton frère. Quitte à tout perdre. J’ignore d’où tu me lis, ni de quel temps, temps de paix ou temps de guerre, temps des humains ou temps des machines, j’espère simplement que ton présent est meilleur que le mien. Nous nous enterrons vivants en nous privant des gestes de l’ivresse : embrassades, accolades, partage et nul ne peut sécher les larmes d’un ami.
Mais si ton temps est pire que celui de ton enfance, si, en ce moment où tu me lis, tu es dans la crainte à ton tour, je voudrais par cette lettre te donner un peu de ce courage dont parfois j’ai manqué et, repensant à ce que nous nous sommes si souvent racontés, tu te souviennes que c’est la bonté qui est la normalité du monde car la bonté est courageuse, la bonté est généreuse et jamais elle ne consent à être comme une embusquée, qui, à l’arrière vit grâce aux sang des autres. Nul ne peut expliquer la grandeur de ceux qui font la richesse du monde. Donne du courage autour de toi et n’accepte jamais ce qui te révulse.
Quant à moi : je t’aime. Ton père t’aime. Sache cela et n’en doute jamais.
Ton père".
Wajdi Mouawad
samedi 11 avril 2020
vendredi 10 avril 2020
mercredi 8 avril 2020
*Tu lisais pour toi-même
Mardi 7 avril 2020
Lettre d' Intérieur
Augustin Trapenard
Par France Inter
"Tu lisais pour toi même (...) contre tout ce qui prétendait te priver d'être..." - Daniel Pennac
Daniel Pennac est écrivain. Il est né à Casablanca et vit à
Paris. Dans cette lettre adressée à une jeune femme croisée dans le
métro avant le confinement, il célèbre avec tendresse, les vertus
libératrices de la lecture.

A une jeune fille qui lisait dans le métro
Ma toute belle,
Tu es, je crois, mon dernier souvenir de métro. De ces temps où nous pouvions nous déplacer tous ensemble, avant que corona ne nous enferme chez nous.
Ligne 6, tu étais assise en face de moi et tu lisais La guerre et la paix de Tolstoï. A en juger par l'épaisseur de ce qui te restait à lire, tu devais être en pleine bataille de Borodino. A cette seconde où le prince André attend l'explosion de l'obus qui tournoie en crachotant à ses pieds et qui le tuera. Tu pouvais avoir dix-huit ans. Dans tes yeux de lectrice l'ardeur disait clairement que tu manquerais ta station. Tu lisais pour toi-même, tu lisais pour Tolstoï, mais tu lisais aussi contre le métro, contre le boulot, contre tout ce qui prétendait te priver d'être.
Ce que tu lisais je l'avais lu plus d'un demi siècle avant toi et je m'en souvenais encore. Est-ce la mort ? se demande le prince André en regardant l'obus fuser si près de lui. Et voilà que pour la première fois il s'intéresse aux herbes qui frémissent, à l'air qu'il respire. Voilà que pour la première fois peut-être, il se sent absolument vivant. Il ne veut pas mourir. Pourtant, à l'officier qui, près de lui, se jette à plat ventre pour ne pas être blessé, il dit : Un peu de dignité, voyons ! Une phrase de ce genre. Et l'obus explose.
Eh bien voilà, ma pitchounette, l'obus a explosé. Il fallait nous y attendre. A force d'attiser le feu sous la cocotte minute, Boum ! On y a tous eu droit. Chacun confiné chez soi sur toute la surface de la planète, mais désireux de vivre encore, comme le prince André. Plus de boulot, plus de métro. Plus que soi. Et tous occupés à espérer.
A espérer quoi, au fait ?
Dans mon cas à espérer que tu puisses un jour raconter ça à des enfants.
"Mes petits, dans les années 20, pendant ce foutu confinement dû au corona virus, j'ai découvert que la lecture sauvait de tous les enfermements. Un matin sur France inter, un type a raconté que le philosophe Antonio Gramsci lisait Kipling et Anna Karenine pour s'évader des prisons de Mussolini, que Soljénitsyne, l'auteur de L'archipel du Goulag, écrivait et lisait contre le bagne et le cancer, que le Chinois Dai Sijie s'était sauvé de son camp de rééducation en lisant Balzac, que, pour ne pas devenir fou, l'otage Jean-Paul Kaufmann avait relu indéfiniment le deuxième volume de Guerre et Paix.
Ce jour-là, les enfants, j'ai donné rendez-vous aux 28 locataires de mon immeuble pour deux heures de lecture quotidienne. Je me suis assise sur mon palier et je leur ai lu Cent ans de solitude, le roman de Gabriel Garcia Marquès. Une heure le soir, une heure le matin, juste avant qu'ils ne s'endorment et juste après qu'ils se réveillent. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce furent les cent plus belles années de nos vies, mais en tout cas ce ne fut pas du temps perdu.
Voilà ma toute belle, je pense qu'un jour tu raconteras ça aux jeunes générations. En attendant, j'embrasse ton beau visage de lectrice. Vivent toi et ton futur.
Daniel Pennac
mardi 7 avril 2020
*Dis-moi oui
par Augustin Trapenard
France Inter
Lettre d'Intérieur
"Et ta moue et ton sourire et ta raideur m’accueilleront. Dis-moi oui." - Christiane Taubira
Christiane Taubira est née à Cayenne. Elle a été Garde des sceaux entre 2012 et 2016. Dans cette lettre adressée à une jeune femme sans abri, elle use de son art de la digression, pour mieux exprimer son inquiétude concernant la vulnérabilité des personnes sans domicile face à l'épidémie.
"Cayenne, le 6 avril 2020
Hello Julie,
Avant tes mots, c’est ta moue puis ton sourire puis une légère raideur vertébrale qui me répondent… m’auraient répondu. Car je ne peux plus passer te voir. C’est ainsi depuis plus de quatre mois maintenant. Je vis à des milliers de kilomètres. Ici, nous n’avons pas besoin de guetter un printemps capricieux. Il fait beau toute l’année. Et ce n’est pas un cliché. Même les deux saisons pluvieuses sont traversées, tous les trois ou quatre jours, d’après-midis ardemment ensoleillées. D’ailleurs depuis quelques temps, ici comme partout, le temps fait comme il veut. Les météorologistes eux-mêmes semblent désorientés. Et je peux te dire que le Covid n’a rien à y voir. C’était déjà comme ça des mois avant ce fléau. C’est étonnant la vie des mots ! Il n’y a pas si longtemps, disons quoi, vingt, trente ans - pour toi qui n’étais pas née, évidemment, ça fait un siècle - donc il n’y a pas si longtemps, calamité était un mot plus fort que fléau. Calamité suggérait une plus grande diversité de dégâts. Je ne crois pas que ça ait à voir avec son genre… féminin. Je pense plutôt que ses sonorités courtisaient l’imagination bien davantage que ne sait le faire le fléau. Assurément, ce n’est pas tout à fait ainsi que le dit le Dictionnaire historique des mots, d’Alain Rey. Mais les savants proposent, les langages populaires disposent.
Je te disais donc, chère Julie, que les météorologistes perdent le nord. Ou plutôt le sens des marées. Il faut dire que c’est à vue d’œil que la mer se livre à des foucades. Elle se retire loin, très loin, laisse remonter puis durcir pendant des heures, d’immenses étendues de vase parcourues ça et là d’entailles plus tendres, presque liquides, où les aigrettes, ces oiseaux au plumage immaculé qui volent en escadrilles, se régalent de larves jusqu’au retour de l’eau. Chez nous, l’eau de la mer est marron car elle reçoit les alluvions de l’Amazone. Cela fait près d’un an déjà que la mer joue à ça. Il n’y aucune raison pour que les choses aient changé ces deux dernières semaines. Je crois plutôt que cela va durer encore une bonne année et que nous verrons revenir plus tôt que d’habitude la mangrove de palétuviers.
Mais je suis incorrigible avec mes digressions ! Ce n’est pas de la mer que j’avais prévu de te parler. Je voulais juste te dire que je pense très fort à toi. Et à quelques autres, ici et chez toi. Je me demande ce que tu deviens. J’avais renoncé à te convaincre. Par respect pour ton choix de liberté. Mais je n’ai jamais cessé d’en être inquiète. J’ai admis ce choix dès la nuit de notre première rencontre.
J’accompagnais une maraude du SAMU. Tu ne voulais pas être hébergée. Admettre ne signifie ni comprendre ni accepter.
Julie ? Julie ???? Tu réponds ? !
Je repasserai. Je reviendrai dans cet angle de rues. Et ta moue et ton sourire et ta raideur m’accueilleront. Dis-moi oui.
Christiane Taubira"
lundi 6 avril 2020
*Seul l'amour sait nous raconter
jeudi 2 avril 2020
par Augustin Trapenard
France Inter
France Inter
Lettre d'Intérieur
"Seul l’amour sait nous raconter à ceux qui savent écouter..." - Yasmina Khadra
Yasmina Khadra est écrivain. Il est né en Algérie. On lui
doit notamment "Les hirondelles de Kaboul". Dans cette lettre adressée à
sa mère décédée, il lui témoigne sa reconnaissance, se souvient
d'instants de grâce, et exprime son désarroi face au temps qui sépare
les êtres qui se sont aimés.

Ma chère petite maman,
Depuis quelques jours, je suis confiné chez moi à cause du coronavirus. L’enfermement est devenu une habitude, pour moi. Je sors rarement. Le temps parisien ne se prête guère à un enfant du Sahara qui ne reconnaît le matin qu’à sa lumière éclatante et qui a toujours rangé la grisaille du côté de la nuit.
Je suis en train de terminer un roman — le seul que j’aurais aimé que tu lises, toi qui n’as jamais su lire ni écrire. Un roman qui te ressemble sans te raconter et qui porte en lui le sort qui a été le tien.
Je sais combien tu aimais la Hamada où tu adorais traquer la gerboise dans son terrier et martyriser les jujubiers pour quelques misérables fruits. Eh bien, j’en parle dans mon livre comme si je cherchais à revisiter lieux qui avaient compté pour toi. Je parle des espaces infinis, des barkhanes taciturnes, des regs incandescents et du bruit des cavalcades. Je parle des héros qui furent les tiens, de Kenadsa et de ses poètes, des sentiers poussiéreux jalonnés de brigands et des razzias qui dépeuplaient nos tribus.
C’est toi qui m’as donné le courage de m’attaquer enfin à cette épopée qui me hante depuis des années. Je craignais de n’avoir pas assez de souffle pour aller au bout de mon texte, mais il a suffi que je pense à toi pour que mes peurs s’émiettent comme du biscuit.
Chaque fois que j’emprunte un chapitre comme on emprunte un passage secret, je perçois une présence penchée par-dessus mon épaule. Je me retourne, et c’est toi, ma maman adorée, ma petite déesse à moi. Je te demande comment tu vas, Là-haut ? Tu ne me réponds pas. Tu préfères regarder l’écran de mon ordi en souriant à cette écriture si bien agencée dont tu n’as pas les codes. Je sais combien tu aimes les histoires. Tu m’en racontais toutes les nuits, autrefois, lorsque le sommeil me boudait. Tu posais ma tête sur ta cuisse et tu me narrais les contes berbères et les contes bédouins en fourrageant tendrement dans mes cheveux. Et moi, je refusais de m’assoupir tant ta voix était belle. Je voulais qu’elle ne s’arrête jamais de bercer mon âme. Il me semblait, qu’à nous deux, nous étions le monde, que le jour et la nuit ne comptaient pas car nous étions aussi le temps.
C’est toi qui m’a appris à faire d’un mot une magie, d’une phrase une partition et d’un chapitre une saga. C’est pour toi, aussi, que j’écris. Pour que ta voix demeure en moi, pour que ton image tempère mes solitudes. Toi qui frisais le nirvana lorsque tu te dressais sur la dune en tendant la main au désert pour en cueillir les mirages ; toi qui ne pouvais dissocier un cheval qui galopait au loin d’une révélation divine, tu te sentirais dans ton élément dans ce roman en train de forcir et tu ferais de chacun de mes points d’exclamation un point d’honneur. Comment oublier l’extase qui s’emparait de toi au souk dès qu’un troubadour inspiré se mettait à affabuler en chavirant sur son piédestal de fortune ?
Pour toi, comme pour Flaubert — un roumi qui n’était ni gendarme ni soldat, rassure-toi — tout était vrai. Etaient vraies les légendes décousues, vraie la rumeur abracadabrante, vrai tout ce qui se disait parce que, pour toi, c’était cela le pouls de l’humanité. Quand il m’arrive de retourner à Oran, je vais souvent m’asseoir à notre endroit habituel et convoquer nos papotages qui se poursuivaient, naguère, jusqu’à ce que tu t’endormes comme une enfant.
C’était le bon vieux temps, même s’il ne remonte qu’à deux ans — deux ans interminables comme deux éternités. Nous prenions le frais sur la véranda, toi, allongé sur le banc matelassé et moi, tétant ma cigarette sur une marche du perron, et nous nous racontions des tas d’anecdotes en riant de notre candeur. Tu plissais les yeux pour mieux savourer chaque récit, le menton entre le pouce et l’index à la manière du Penseur.
Mon Dieu ! Que faire pour retrouver ces moments de grâce ? Quelle prière me les rendrait ? Mais n’est-ce pas dans l’ordre des choses que de devoir restituer à l’existence ce qu’elle nous a prêté ? On a beau croire que le temps nous appartient, paradoxalement, c’est à lui que revient la tâche ingrate de séparer à jamais ceux qui se chérissent. Ne reste que le souvenir pour se bercer d’illusions. Ma petite maman d’amour, depuis que tu es partie, je te vois dans toute grand-mère ? Qu’elles soient blondes, brunes ou noires, il y a quelque chose de toi en chacune d’elles. Si ce ne sont pas tes yeux, c’est ta bouche ; si ce n’est pas ton visage, ce sont tes mains ; si ce n’est pas ta voix, c’est ta démarche ; si ce n’est rien de tout ça, c’est l’émotion que tu as toujours suscitée en moi.
Et pourtant, partout où je vais, même là où il n’y a personne, c’est toi que je vois me faire des signes au fond des horizons. Tantôt étoile filante dans le ciel soudain triste que tu lui fausses compagnie, tantôt île de mes rêves au milieu d’un océan de tendresse aussi limpide que ton cœur, tu demeures mon aurore boréale à moi. Si je devais un jour te rejoindre, maman, je voudrais qu’il y ait une part de nous deux dans tout ce qui nous survivrait. Puisque seul l’amour sait nous raconter à ceux qui savent écouter.
Yasmina Khadra
dimanche 5 avril 2020
*Je vous aime
"Mes chéris, savez-vous combien je vous aime ?" Susie Morgenster
mardi 31 mars 2020
par Augustin Trapenard
France Inter
France Inter
Lettre d'Intérieur
Susie Morgenstern est née dans le New Jersey, aux Etats
Unis. Elle vit et travaille à Nice, où elle écrit des livres pour la
jeunesse. Dans cette lettre adressée à ses petits-enfants, elle parle de
procrastination, d'écriture et de solidarité.

Chers Yona, Noam, Emma et Sacha,
Vous le savez déjà : je ne suis pas une fée du ménage. Je suis disciplinée pour certaines choses et pas pour d’autres. Mais, je voudrais profiter de cette période de confinement à Nice pour faire le grand nettoyage de printemps sachant que je ne suis pas douée.
Je vais vraiment m’appliquer. D’abord, j’écris quelques lignes pour me donner du courage et puis promis, j’y vais. Et oui, je préfère écrire une histoire que de faire le tri dans mes affaires. Me voilà prête. J’ouvre un tiroir, la boîte de Pandore, une jungle de machins et de trucs que la consommation frénétique de ma jeunesse a fait s’accumuler. Je regarde, consternée, mais je ne touche à rien ! Est-ce que j’ai vraiment besoin de quatre louches, trois couteaux à pain, six paires de ciseaux, cinq agrafeuses et des collections infinies de pacotille ?
Je ne referme pas le tiroir, mais je m’enfuis devant mon écran. Tout sauf ça. La mauvaise conscience me pousse à y retourner et à contempler la scène du crime. Je garde tout, au cas où l’un de vous en aurait besoin le jour où vous vous installerez en ménage. (Il y a une louche pour chacun d’entre vous !)
Je prépare mon déjeuner.
Le tiroir me nargue. Après la sieste, peut-être …
Au lit, je ne me permets pas plus de cinq pages de relecture de Virginia Woolf « Une chambre à soi ». Au compte gouttes pour savourer. Et comme chaque fois que je lis un chef d’œuvre, j’espère que vous le lirez aussi. Que vous lirez tout court !
Je retourne au travail. Je parcours mes messages. On me demande un article. Autant commencer tout de suite. Mais le tiroir est ouvert comme la bouche béante d’un monstre. Je remarque un chocolat qui aurait pu être là depuis l’antiquité.
Je le mange. Et puis d’un coup décisif et déterminé, je vide le tiroir pour former une montagne sur la table de la salle à manger. Il y a un vieux cahier et des stylos. Je m’assois pour les essayer et je retrouve le plaisir d’écrire sur du papier. Je pense à tous mes manuscrits écrits à la main avec nostalgie.
Mes yeux tombent sur un paquet de ballons de toutes les couleurs, un stock suffisant pour une future fête gigantesque. J’en gonfle un. Puis, un à un, je les gonfle tous. C’est un effort considérable, mais je ne peux pas m’arrêter. Les ballons remplissent la maison de légèreté, d’espoir, de folie. Un à un je les envoie par la fenêtre, mon message de gratitude et d’admiration au personnel soignant. Je les connais bien après ma longue maladie, ces anges sur terre, nos héros. Chaque ballon dit « I love you ! »
Comme les ballons sont appropriés
! Aujourd’hui c’est mon anniversaire: j’ai 75 ans ! Happy birthday to me !
Mes ballons expédiés, je fixe le contenu du tiroir, je fais les cent pas et d’un geste définitif et concluant, je remets toute la pagaille à sa place. Dans un mois peut-être ?-
Entre temps, ne serait-il pas urgent et important de vider le tiroir du bric à brac qui se trouve dans ma tête ?
Mes chéris, savez-vous combien je vous aime ?
Votre Bubie, Susie Morgenstern
mercredi 1 avril 2020
Mon livre de prières...
Le jeu de cartes
"Mesdames messieurs, ce jeu de cartes, c'est ma bible et mon livre de prières.
Je sais ça peut vous paraître bizarre mais quand je regarde l'as, il me rappelle que nous n'avons qu'un seul dieu.
Quand je vois le 2 je me souviens que la Bible est divisée en 2 parties : l'ancien et le nouveau testament.
Quand je vois le 3, je pense au père, au fils et au saint esprit.
Quand je vois le 4 je songe aux 4 disciples qui prêchèrent la bonne parole. Il y avait Mathieu, Marc, Luc et Jean.
Quand je vois le 5 je pense aux 5 vierges qui coupaient les mèches de leur lampe.
Quand je regarde le 6 je me souviens que Dieu a eu besoin de 6 jours pour créer le ciel et la terre.
Le 7 me ramène à l'esprit que le 7ème jour il se reposa.
Devant le 8 je songe aux 8 personnes droites et justes que Dieu a sauvé lorsqu'il détruisit la terre.
Quand je regarde le 9 je pense aux lépreux que notre seigneur purifia : 9 sur 10 ne l'ont pas remercié.
Le 10 représente les 10 commandements.
Le valet, lui c'est le diable.
La reine, c'est la sainte vierge bénie entre toutes les femmes et le roi me rappelle encore une fois qu'il n'y a qu'un roi dans l'univers : Dieu tout puissant.
Vous voyez mesdames messieurs, si je compte tous les points dans un jeu de cartes il y a 365 : le nombres de jours dans une année.
Il y a 52 cartes : le nombre de semaines dans une année.
Il y a 12 personnages, le nombre de mois.
Il y a 4 familles, les 4 saisons.
Vous voyez mesdames messieurs, ce jeu de cartes, c'est ma bible et mon livre de prières."
par Roland Magdane
Inscription à :
Commentaires (Atom)


